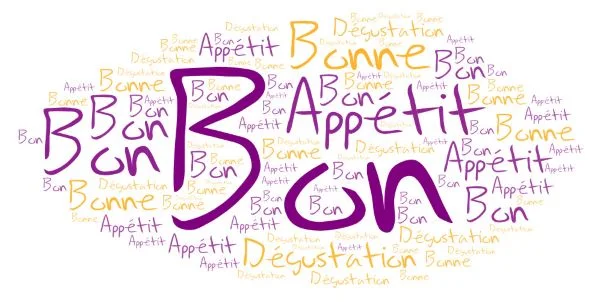1- L' Orange, la Janus douce et amère.
C'est l'orange amère dont on fait les confitures qui débarqua la première en Europe, rapportée de Palestine par les croisés.
La Chine inonde le monde entier avec sa production industrielle. Pourtant, elle ne surpassera jamais sa première exportation : l'orange. Car l'oranger est bel et bien d'origine chinoise. Au fil des millénaires, l'arbre accomplira une longue marche vers l'Ouest. Les croisés découvrirent l'orange en Palestine et la rapportèrent chez eux.
Une orange comme cadeau de Noël
Mais il ne s'agissait pas encore de la nôtre, douce et sucrée, mais de la bigarade, l'orange amère. Elle ne se mange pas, mais sert à fabriquer des marmelades. Ses fleurs, très parfumées, font des parfums. Quelques siècles après nos chevaliers en armure, c'est au tour des navigateurs portugais, au XVIe siècle, de découvrir l'orange en Chine, mais l'orange douce. L'oranger s'adapte parfaitement au climat européen, remontant bientôt la vallée du Rhône jusqu'à la ville qui lui doit son nom… Orange.
Durant quatre siècles, l'orange toise de haut les autres fruits, trônant sur les tables aristocratiques, puis bourgeoises. Avant-guerre, encore, on offrait une orange à Noël. Aujourd'hui, la belle vaniteuse est devenue une roturière des plus communes. Chaque année, la production mondiale avoisine 80 millions de tonnes, soit 800 milliards de fruits. Cent fois plus que d'humains.
2- La fraise, la belle américaine
C'est le plus banal et le plus mystérieux des fruits. Son secret honteux : la fraise n'est surtout pas le fruit du fraisier.
Beaucoup de fruits ne sont que des usurpateurs, telle la fraise. S'ils portent le nom de fruit, ils n'en sont pourtant absolument pas d'un point de vue botanique. La vidéo ci-jointe vous dévoilera le secret honteux de la fraise, qui a le tort de trop la ramener.
Autre devoir de vérité : sachez que la grande famille des fraises compte deux branches très éloignées : la fraise des bois, dont se régalaient déjà nos ancêtres de Cro-Magnon, petites et goûteuses ; et la grosse fraise industrielle, d'origine américaine, souvent aussi savoureuse qu'un morceau de coton.
Toutes les fraises, hormis celles des bois, sont les descendantes trafiquées de plants rapportés d'Amérique. On suppose que Jacques Cartier fut le premier au XVIe siècle. Le deuxième était un espion français justement dénommé Frézier, envoyé par Louis XIV au Chili et au Pérou pour relever les fortifications espagnoles. Ayant la passion des plantes, il rapporta en France cinq plants d'un arbuste à gros fruits blancs. Des fraises blanches. Il en donna quatre à des botanistes et en conserva un pour le planter dans sa propriété de Plougastel. C'est ainsi que cette localité bretonne devint la capitale française de la fraise. Mais pas immédiatement, car ce malheureux Frézier n'avait rapporté que des pieds mâles incapables de fructifier. Ce n'est qu'avec l'introduction d'une autre espèce rapportée en Europe de Virginie que les fraisiers de l'espion purent enfin donner des fruits métissés. Lesquels furent à l'origine de nos espèces de table.
À noter que Frézier ne portait pas ce nom par hasard. Un de ses ancêtres nommé Julius Berry offrit en 916 un magnifique plat de fraises des bois au roi Charles III qui l'en remercia en l'anoblissant et en lui donnant le nom de fraise qui devint Frazer après un séjour de ses descendants en Angleterre, puis Frazier après un retour en Savoie.
3- La pêche, l'aristocrate au sang chinois
La juteuse pêche, au départ simple fruit vert et fibreux, quitta la Chine par la route de la Soie pour l'Occident plusieurs siècles avant notre ère.
Pourquoi « pêche » ? Ne cherchez pas trop loin, cette dénomination est tout simplement empruntée à la Perse. C'est Alexandre le Grand qui, dit-on, aurait rapporté ce magnifique fruit d'origine chinoise. Son nom savant est encore plus explicite : Prunus persica. Le pêcher appartient à la grande famille des Rosaceae qui comprend, entre autres, l'aubépine, le prunellier, l'églantier (donc le rosier) mais aussi le fraisier, la pimprenelle et la reine-des-prés.
En France, le pêcher est cultivé depuis le Moyen Âge ; des noyaux ont été même découverts dans des dépôts remontant à l'époque gallo-romaine. Pendant longtemps, la belle à la peau de velours est restée un fruit de luxe, réservé à l'aristocratie. Louis XIV l'adorait. Son jardinier en cultivait une quarantaine d'espèces à Versailles. Il y avait la « Grosse Mignonne », la « Belle de Chevreuse », la « Téton de Vénus ». C'est à cette époque que débute la culture en espalier, à Montreuil. Les vergers étaient alors divisés en petites parcelles entourées d'un mur recouvert de plâtre pour augmenter son inertie thermique. Un petit toit protégeait les fruits des pluies de printemps. Dans ces parcelles isolées, la température pouvait gagner une dizaine de degrés. Les pêchers étaient greffés sur des amandiers porte-greffe plus adaptés aux sols calcaires. Les jardiniers brossaient leurs pêches avec une brosse en poils de porc pour supprimer le duvet. Après avoir conquis la table du Roi-Soleil, les pêches de Montreuil gagnèrent les tables royales d'Angleterre et de Russie.
4- La figue, le fruit défendu
Rectifions une erreur biblique : Ève ne tendit pas un pomme à Adam pour croquer dedans, mais une figue.
Le figuier est le seul membre européen d'une famille tropicale, les ficus, comptant plus de 600 membres. Comme il est cultivé depuis des millénaires dans le bassin européen, il apparaît dans de nombreux mythes et narrations. Pour échapper au monstre marin Charybde, Ulysse s'accroche à un figuier. Plutarque signale que le suc du figuier attendrit la chair d'un pendu. On allait oublier, sous quel arbre croyez-vous que Remus et Romulus, les fondateurs de Rome, tétaient leur louve ? Mais sous un figuier !
Avant de passer au jardin d'Éden, signalons que, tout comme la fraise, la figue n'est pas un fruit, mais une infrutescence. Celle-ci abrite les fleurs (filaments roses) et les fruits (les grains qui croquent sous la dent). Ceux-ci ne voient jamais le jour, d'où la nécessité de recourir à de microscopiques insectes volants pour assurer la reproduction.
Mis à l'index par l'Église
Dans leur jardin d'Éden, Ève et Adam ont d'autres choix à fouetter que de noter la nature exacte des plantes qui les entourent. Le Nouveau Testament ne manifeste pas davantage d'intérêt à la botanique en se contentant de nommer le fruit défendu : pomum. Ce qui en latin signifie tout banalement : fruit. Du coup les artistes voulant représenter la scène ont dû improviser.
Pomum, ressemblant à pomme. Donc, allons-y pour la pomme. Mais certains ont encore opté pour la grappe de raisin. Les plus finauds choisirent la figue tout simplement, puisqu'après avoir désobéi à Dieu, nos deux ancêtres simplets ont subitement découvert qu'ils étaient sexués. Le rédacteur du verset 7, Genèse 3, écrit : « Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. » Par la suite, la figue devint un symbole érotique qui l'a fait mettre à l'index par l'Église.
Source :
Articles publies par le journaliste Fréderic Lewino sur Le Point.fr
https://www.lepoint.fr/
Vidéos : https://www.dailymotion.com/LePoint